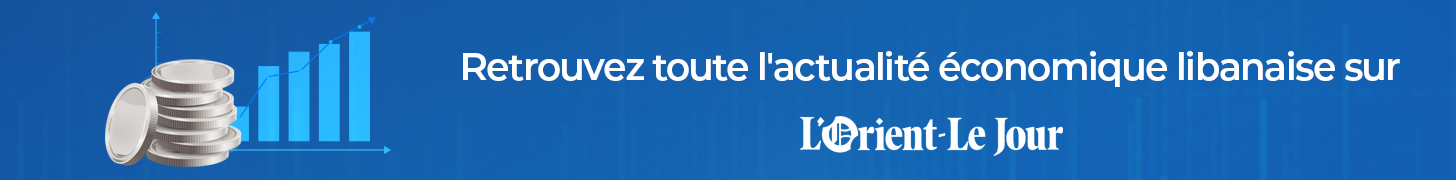Définition
Selon la définition de l’ONU, la population active (ou économiquement active) comprend toutes les personnes qui fournissent, durant une période de référence spécifiée, la main-d’œuvre disponible pour la production de biens et de services. Cette définition englobe les personnes pourvues d’un emploi ainsi que les chômeurs, y compris les personnes à la recherche d’un premier emploi.
La production de biens et de services économiques comprend toutes les activités de production qu’elles soient destinées à la vente, au troc ou à l’autoconsommation. On inclut, par exemple, la construction pour compte propre dans la production de biens et de services économiques. Les membres des forces armées sont également comptabilisés dans la population active.
Comprendre la variable
Indépendamment de toute considération morale ou légale, il est évident que l’activité économique est exercée naturellement par une tranche d’âge qui exclut d’une part les enfants et d’autre part les vieilles personnes.
La population active est un concept économique duquel sont tirées des considérations sur la productivité du travail ou le niveau de formation des ressources humaines. D’un point de vue purement quantitatif, la population active doit être appréciée en plusieurs étapes. Il faut d’abord mesurer la “population en âge actif” qui dépend de la structure démographique d’un pays donné. Il faut ensuite évaluer le “taux d’activité effectif”, c’est-à-dire le pourcentage de gens réellement actifs, qui participent à la production ou cherchent à y participer, par rapport aux résidents en âge actif. Il faut enfin distinguer, au sein de la population active, les actifs effectifs des chômeurs (involontaires), ce qui n’est pas toujours évident.
La population en âge actif
Selon l’usage international, la population en âge actif regroupe toutes les classes d’âge situées entre 15 et 64 ans (révolus). L’évaluation du nombre de personnes concernées permet de calculer le ratio de dépendance (démographique) qui mesure le nombre d’inactifs pour cause de jeunesse ou de vieillesse rapporté au nombre de personnes en âge actif.
Elle permet aussi de calculer le “rapport de soutien potentiel” (ou démographique), c’est-à-dire le rapport de la population d’âge actif (15 à 64 ans) à la population âgée (65 ans et plus).
La configuration démographique d’un pays à une date donnée a une influence directe sur la croissance économique. Dans deux cas extrêmes symétriques, un ratio de dépendance élevé correspond soit à une population en pleine croissance démographique (avec une proportion élevée d’enfants de moins de quinze ans), soit à une population vieillissante (proportion élevée de personnes âgées). Dans ces deux cas se posent des problèmes économiques et sociaux : celui du coût de l’éducation des enfants pour l’un, celui du coût du système de santé et de la soutenabilité des régimes de retraite pour l’autre.
Entre ces deux situations se situe le troisième cas qui correspond à un “cadeau” démographique du point de vue économique : le ratio de dépendance est au minimum, la poussée démographique a déjà eu lieu, mais le vieillissement n’est pas encore arrivé, ce qui signifie que la population en âge actif constitue un véritable moteur économique pour l’ensemble de la société avec un minimum de “charge” démographique. C’est ce que les démographes appellent la “transition démographique”.
Le taux d’activité
Après avoir mesuré la population en âge actif ou potentiellement active (suivant les conventions retenues), on cherche à évaluer la part de gens réellement actifs. Ici apparaissent plusieurs difficultés que la définition officielle de l’ONU suggère assez clairement.
La première difficulté concerne la couverture territoriale des enquêtes et des sondages réalisés pour évaluer la population active : la base du recensement étant la population résidente, le travail des non-résidents “transhumants” n’est pas comptabilisé. C’est le cas au Liban avec les travailleurs syriens dont les effectifs (dans l’agriculture et la construction) sont sans doute sous-estimés.
La seconde difficulté porte sur la définition du “travail” et de la “volonté de travailler”. Comment prendre en compte les activités de production destinées à l’autoconsommation d’un ménage ou une construction pour compte propre ? Les gens ne considèrent pas spontanément ce type d’activité comme du “travail”, car le terme de travail est associé à un caractère “marchand”. Une boutade célèbre dit que la production et la population active augmenteraient si les femmes au foyer étaient rémunérées par le chef de ménage (qui pourraient être elles-mêmes) pour leur travail domestique et si elles versaient en contrepartie un loyer pour leur logement. Donc, par convention, le travail domestique non marchand n’est pas considéré comme une production. Mais le travail des femmes reste problématique dans le monde agricole et dans l’artisanat où sa part peut être importante et reste souvent ignorée ou sous-évaluée.
Le taux de chômage
La question du chômage est particulièrement sensible. Le taux d’activité effectif dépend, bien entendu, du niveau de chômage dans l’économie. Ce dernier peut amputer gravement la capacité productive d’un pays. Dans certains cas, il atteint 20 à 25 % de la population active.
Les pays qui prévoient des indemnités de chômage sont tenus d’adopter une définition opérationnelle précise du phénomène et les modifications des périmètres de définition du chômage constituent un enjeu politique permanent, car elles modifient beaucoup les résultats. En l’absence de mécanismes d’indemnisation du chômage, l’évaluation du phénomène reste tributaire des enquêtes de population active pour lesquelles la définition quantitative des questionnaires doit être la plus précise possible.
Par exemple, dans l’enquête réalisée en 2004 au Liban par l’Administration centrale de la statistique (ACS), toute personne ayant “travaillé” une heure ou plus durant la semaine précédant l’enquête ou s’est absentée du travail pour cause de congé, de maladie ou de maternité est considérée comme effectivement active.
Sur cette base, le taux de chômage est le rapport du nombre de chômeurs et des personnes à la recherche d’un premier emploi à l’effectif de la population active.
La variable au Liban
Les statistiques démographiques et économiques libanaises sont notoirement insuffisantes. Trois enquêtes sur la population active ont été réalisées par l’Administration centrale de la statistique en 1970, 1996 et 2004. D’autres travaux ont été réalisés par différentes institutions à des dates proches de celles des trois enquêtes (le ministère des Affaires sociales et l’Université Saint-Joseph notamment).
Les résultats ne sont pas directement comparables, car les périmètres de couverture ne sont pas strictement équivalents, notamment pour ce qui concerne le traitement des Palestiniens des camps (exclus par convention des enquêtes). Les phénomènes massifs de migration (émigration et immigration) ne sont pas davantage pris en compte.
Malgré ces réserves, les résultats appellent trois commentaires majeurs :
1) Entre 1970 et les années 90, le Liban est entré de plain-pied dans la transition démographique : les effectifs des moins de 15 ans n’ont augmenté que de 12,8 % en 26 ans contre un accroissement global de plus de 75 % de la population résidente. De ce fait, même si la population âgée commence déjà à augmenter plus vite que la population totale et que la population en âge actif, les taux de dépendance démographique et effectif ont chuté de manière considérable : il y a deux personnes en âge actif pour une personne hors âge actif aujourd’hui contre une seule en 1970 ; pour un actif, il y a 2,5 non-actifs aujourd’hui contre 3,3 non-actifs en 1970.
2) Le taux d’activité n’a pas bougé et il est resté à un niveau particulièrement bas : moins de la moitié de la population en âge actif est effectivement active. Ainsi, si la population en âge actif a augmenté (malgré l’émigration) de 120 % sur la période, la population active a augmenté un peu moins (+118 %) et le nombre des actifs effectifs encore un peu moins (+114 %).
3) La situation démographique s’est sensiblement détériorée entre 1996 et 2004 : on assiste de manière prématurée et accélérée au double phénomène de déclin et de vieillissement de la population dont commencent à souffrir les pays riches. En moins de huit ans, la population active et les actifs effectifs ont diminué de près de 10 % ! L’ensemble de la population a baissé de près de 6 %, les jeunes de plus de 8 %. Seule la catégorie des vieux voit ses effectifs augmenter de 9 %. L’ampleur de ces développements est telle que l’on doit vérifier la fiabilité des résultats de 1996 et de 2004, mais ils sont indéniables. Ces observations devraient normalement susciter une réflexion en profondeur dans le pays.
En résumé, le Liban est en train de dilapider sa transition démographique du fait de la saignée massive que représente l’émigration. Le pays devrait se trouver aujourd’hui au plus fort de sa capacité productive, et donc en pleine croissance. Les chiffres des ratios de dépendance auraient dû, sans l’émigration qui touche principalement les jeunes actifs ou en âge d’activité, être encore plus favorables que ceux qui se dégagent des résultats bruts déjà décrits.
Émigration et faible taux d’activité des femmes
L’examen de la situation libanaise fait apparaître trois problèmes essentiels : l’émigration, le faible taux d’activité globale et le faible taux d’activité des femmes en particulier.
L’évolution des taux d’activité des tranches d’âge actif (15 à 64 ans) est parlante à cet égard.
On constate que :
• Le taux d’activité féminine est particulièrement faible (à peine plus de 20 %). Sa progression depuis 1970 de 16 à 22 %, bien que modeste, surestime probablement la réalité pour deux raisons : la première est que, si les femmes actives dans l’agriculture sont souvent omises des statistiques, la part de l’activité agricole a considérablement baissé sur la période et la dose de sous-estimation s’est donc trouvée réduite ; la deuxième raison est que les statistiques comprennent les employées de maison étrangères dont les effectifs ont énormément augmenté sur la période, ce qui réduit d’autant la participation à l’activité économique des femmes libanaises.
• Le taux d’activité masculine n’est pas bien élevé non plus. Il accuse d’ailleurs une baisse sensible sur la dernière période. Une des raisons en est l’allongement de la durée des études, mais il y a sans doute aussi un effet indirect de l’émigration avec des émigrés revenant au pays avant la fin de l’âge actif et vivant de leurs rentes.
• Globalement, le taux d’activité des femmes a un peu augmenté, mais le taux d’activité générale est resté constant ; cela est dû à la baisse du taux d’activité masculine et à la plus forte émigration chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes ; le second phénomène négatif a annulé les modestes effets positifs du premier.
Dans le graphe qui présente l’évolution des taux d’activité par âge et par sexe, en 1970, en 1996 et en 2004, on peut relever que :
• L’âge d’entrée dans la vie active a significativement reculé depuis 1970, le taux d’activité des tranches d’âge 15-19 ans et 20-24 ans a baissé de 10 et de 5 %, du fait de l’allongement de la durée des études.
• Les hommes sortent relativement tôt de la vie active : 15 % d’inactifs entre 50 et 54 ans, plus de 20 % entre 55 et 59 ans, et près de 30 % entre 60 et 64 ans. Nous ne disposons malheureusement pas de la distribution des occupations par nationalité, mais on peut penser que ce phénomène est dû en partie au retour prématuré d’émigrés qui s’installent en rentiers mais aussi à la concentration des travailleurs étrangers dans les tranches d’âge jeune. Cela voudrait dire que les taux d’activité des hommes libanais résidents seraient sensiblement inférieurs aux niveaux observés.
• Les femmes entrent peu dans la vie active (le pic du taux d’activité ne dépasse pas 35 %, le plafond étant sensiblement inférieur pour les Libanaises seules) et en sortent progressivement (le taux d’activité est déjà inférieur à 25 % dans la tranche d’âge des 35 à 39 ans). Après dix ans, 40 % des femmes actives ont déjà quitté le travail, probablement après leur mariage pour élever leurs enfants.
Pour expliquer le phénomène de la faible activité féminine au Liban, on ne peut invoquer ni de soi-disant facteurs “culturels”, comme en Arabie saoudite par exemple, ni un problème d’accès différentiel à l’éducation entre les filles et les garçons. Au Liban, le travail de la femme est valorisé pour toutes les catégories de la société et l’éducation des filles est équivalente à celle des garçons à tous les niveaux.
Il faut chercher la raison de ce phénomène dans le niveau élevé du salaire de réservation. Cette notion mesure le niveau de salaire à partir duquel une personne (une femme en l’occurrence) est incitée à travailler, en acceptant les inconvénients que cela comporte pour son foyer, en raison des gains de pouvoir d’achat qu’elle peut espérer. Or, au Liban, les revenus accessibles aux femmes (soit directement, soit comme incrément du revenu de l’homme dans le cas des entreprises familiales) sont trop faibles pour qu’elles franchissent le pas. Cela est dû au niveau élevé des prix domestiques qu’alimentent une demande exogène, à la structure rudimentaire de la majorité des entreprises libanaises, et à l’absence de facilités pour la garde et les loisirs des enfants.
Ce même raisonnement s’applique aux hommes et à l’émigration : préférer ne pas travailler ou émigrer est le fruit de la même évaluation de l’opportunité comparative d’accepter un salaire donné. Notons que si 40 % des femmes travaillaient au Liban au lieu de 20 %, cela voudrait dire que la population active augmenterait de 20 % environ, soit un saut du PIB du même ordre : l’enjeu est majeur.
Sous l’angle des taux d’activité comme sous l’angle démographique, les observations témoignent de l’incapacité de l’économie libanaise à profiter de ses ressources, à une période où celles-ci sont les plus abondantes et où des dépenses considérables sont consenties pour l’éducation de jeunes générations. Le Liban est en train de rater le bénéfice de la transition démographique et de ses investissements dans le capital humain.
(*) Économiste. www.charbelnahas.org
Conséquences du vieillissement de la population
Un récent rapport de l’ONU met en évidence les conséquences du vieillissement des pays développés à travers le calcul du ratio de dépendance (inactifs/population en âge actif) prévu dans 50 ans. Le seul moyen de compenser sa très forte augmentation est de recourir à une immigration massive, affirme l’étude.
Le rapport montre, par exemple, que le Japon et pratiquement tous les pays d’Europe connaîtront une diminution de leur population au cours des 50 prochaines années. Ainsi, la population de l’Italie qui se situe à 57 millions actuellement devrait décliner pour atteindre 41 millions d’ici à 2050 (-28 %). La population russe devrait passer de 147 à 121 millions sur la période (-18 %). De même, la population du Japon qui s’élève à 127 millions actuellement passerait à 105 millions d’ici à 2050 (-17 %).
La diminution de la population s’accompagne de son vieillissement relativement rapide. Ainsi, au Japon, l’âge moyen de la population devrait augmenter d’environ huit ans au cours du prochain demi-siècle, c’est-à-dire de 41 à 49 ans. Et la proportion de la population âgée de 65 ans ou plus devrait passer de 17 % actuellement à 32 %. De même en Italie, l’âge moyen de la population passera de 41 à 53 ans et la proportion de la population âgée de 65 ans ou plus, qui est de 18 % actuellement, atteindra 35 %.
Résultat, le “ratio de soutien potentiel” de plusieurs pays va diminuer de façon inquiétante. Celui de la France passera de 4,36 en 2000 à 2,26 en 2050. Celui de l’Union européenne de 4,31 à 1,96. Le bond le plus spectaculaire est celui de la Corée, qui passera de 12,6 à 2,4. Ce qui signifie qu’un même nombre d’actifs aura à sa charge au moins deux fois plus de non-actifs. À défaut d’une immigration massive en mesure de rétablir l’équilibre, les pays concernés devront revoir toute la structure de leur système économique et social.
http://www.un.org/esa/population/publications/migration/migration.htm
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres éditoriales et publicitaires adaptées à vos centres d’intérêts et mesurer la fréquentation de nos services.
En savoir plus