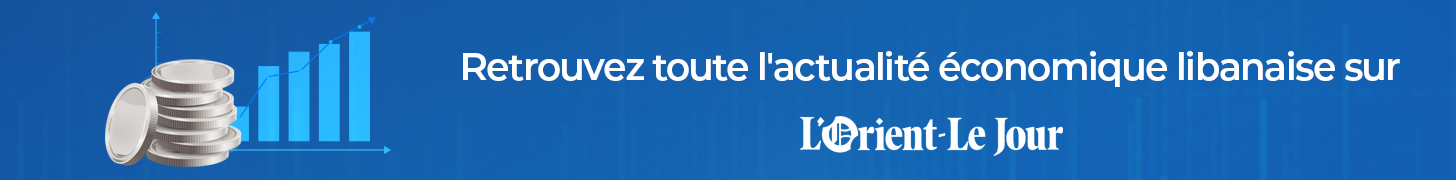À l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, Le Commerce du Levant fait le point sur les nombreuses discriminations à leur égard qui persistent au Liban.
Que ce soit au niveau du travail, des allocations familiales, du divorce, de l’héritage ou même du témoignage devant la justice, les inégalités entre les hommes et les femmes au Liban sont patentes.
De nombreuses discriminations persistent dans les lois, « sans compter les pratiques sociétales », assure Nathalie Chémali de l'association Women Economic Empowerment Project. Tour d’horizon des principales lacunes.
Congé maternité
Ce projet de réforme du code du travail reste de toutes les façons en dessous des conventions internationales comme celles de l’Organisation internationale du travail (OIT) dans laquelle le congé maternité est de 14 semaines minimum, payés au moins au deux tiers du salaire par la sécurité sociale.
Dans le monde arabe, seule la Syrie a mis en place un congé maternité de 14 semaines, payé à taux plein. Ce qui la positionne dans le peloton de tête, au même rang que les pays de l’Union Européenne. En France, par exemple, le congé maternité est de 16 semaines pour un premier enfant et de 26 semaines pour un troisième.
Allocations familiales
Le décret 3950 du 27 avril 1960 (article 3) prévoit pour les hommes fonctionnaires, en tant que chefs de famille, des allocations familiales au titre de leur épouse et de leurs fils qui n’ont pas atteint 18 ans (voire de leurs fils jusqu’à 25 ans si ceux-ci poursuivent leurs études). Ce décret leur octroie également des allocations en ce qui concerne leurs filles célibataires, veuves ou divorcées, qui n’ont pas de pensions par ailleurs.
En revanche, les femmes fonctionnaires qui deviennent chefs de famille, dans le cas d’un divorce, n’ont pas droit à ces allocations familiales.
Pour les salariés du secteur privé, la loi 149 du 30 octobre 1999 assure l’égalité de principe entre homme et femmes. Toutefois, en cas de divorce, les salariées n'ont droit à des allocations que si leur ancien mari ne les réclame pas. Et ce même si l'homme n'a pas la charge des enfants nés de leur union.
Commerce
Malgré le régime matrimonial libanais dans lequel la séparation des patrimoines entre le mari et la femme prévaut, les articles 625 à 629 du code du commerce affirment que l'on doit prendre en compte une partie des biens de la femme en cas de faillite de son époux. L'inverse n'est pas valable.
Transmission de la nationalité
Avant 1960, la femme qui se mariait perdait automatiquement sa nationalité et prenait celle de son mari. Aujourd’hui, la femme conserve sa nationalité… mais ne peut encore la transmettre ni à ses enfants ni à son mari (sauf pour son enfant naturel qu’elle reconnaîtrait avant le père). Depuis septembre toutefois, un décret donne aux enfants nés d’une mère libanaise et d’un père étranger la possibilité d’obtenir un permis de séjour de trois ans (au lieu d’un an auparavant). Du moins en théorie.
Selon l’Onu, 18.000 libanaises se sont mariées à des étrangers entre 1995 et 2008 et quelque 41.000 enfants sont concernés.
Liberté de circulation
Jusqu’en 1974, une autorisation écrite du mari était exigée pour délivrer un passeport à son épouse et la laisser quitter le pays. Aujourd’hui, cette autorisation est exigée lorsque la femme entreprend un voyage en compagnie de ses enfants mineurs. L’homme en revanche n’a pas besoin d’autoriser pour voyager seul avec ses enfants.
Témoignage devant la justice
Le témoignage d’une femme libanaise musulmane n’est pas recevable devant les tribunaux religieux, au même titre d’ailleurs que celui des enfants mineurs, des fous ou des handicapés. Il faut le témoignage concordant de deux femmes pour qu’il soit accepté par les moukhtars.
Le témoignage des femmes (toute communautés confondues) n’est de même pas recevable devant le registre foncier, ce qui encore une fois l’assimile à une mineure ou aux personnes incapables de témoigner comme les sourds, les aveugles et certains individus pénalement condamnés.
Crime d’honneur
L’article 562 du Code pénal, concernant les crimes d’honneur, est toujours en vigueur au Liban. Il accorde des « excuses » ou des « circonstances atténuantes » à l’individu qui tuerait sa femme, sa sœur, sa mère… ayant « eu un rapport sexuel illicite ou qu’il trouverait dans une situation apparemment compromettante ».
Tutelle
En cas de décès du mari, la mère ne devient pas automatiquement la tutrice légale de ses enfants. Chez les musulmans, en présence d’un grand-père paternel, les tribunaux religieux accordent quasi automatiquement la tutelle à celui-ci (et donc la gestion de la fortune de son
fils défunt). À défaut, la tutelle revient aux hommes du côté maternel. Chez les chrétiens, le même cas de figure prévaut à l’exception des catholiques, qui favorisent la mère… à condition que celle-ci ne se remarie pas.
Mariage et divorce
Si le divorce est reconnu dans la religion musulmane, seul le mari est habilité à demander le divorce ou à répudier. Cependant nombre de femmes musulmanes exigent que soit mentionnée dans leur contrat de mariage la possibilité de demander le divorce.
Seule la communauté druze permet aux femmes de demander le divorce, sans stipulation initiale dans le contrat, et reconnaît le divorce par consentement mutuel.
Dans la communauté grecque orthodoxe (également chez les syriaques et les assyriens), la « nullité du mariage » (équivalent du divorce) est admise dans certains cas précis. Chez le reste des chrétiens, l’annulation n’est possible que si l’on invoque « une folie passagère » ou une « erreur sur la personne ».
Héritage
Chez les chrétiens et les juifs, la loi civile de 1959 reconnaît l’égalité entre homme et femme en matière d’héritage. En revanche, selon le droit musulman, l’homme, qu'on estime responsable des dépenses de la maison, hérite du double de la part de la femme.
Notons toutefois que dans la communauté chiite, une fille reçoit la totalité de l’héritage laissé par son ascendant (son père par exemple) en l'absence de fils. Chez les sunnites, elle ne reçoit qu’une partie (un tiers), le reste allant à une autre branche mâle de la famille.
Mais la femme dans la communauté musulmane peut prétendre (en cas de divorce ou de veuvage) à la nafaqah, qu'on peut assimiler à une pension alimentaire.