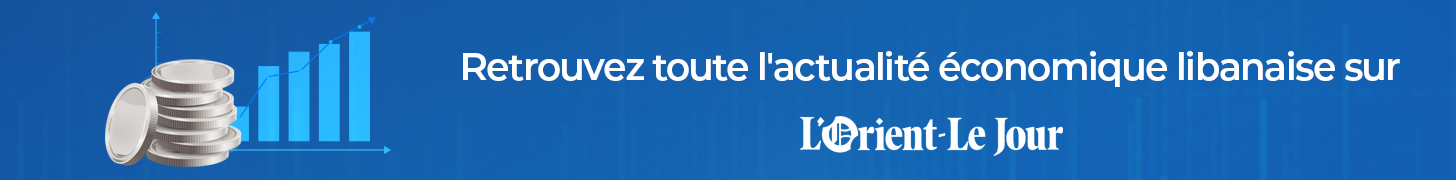Le “miracle” n’agit plus ; nous ne sommes plus une nécessité économique pour le monde arabe. Face à cet écroulement, l’ébauche d’un nouveau rôle régional. Sous conditions…
La redéfinition du rôle régional de l’économie libanaise se place, comme un refrain, au centre de presque tous les débats économiques depuis la fin de la guerre et plus précisément depuis le lancement des programmes de reconstruction en 1993. Malgré cette omniprésence verbale, une grande confusion règne toujours quant aux leçons concrètes que les Libanais ont pu tirer et aux orientations à prendre à ce niveau.
Miracle économique
Longtemps associé au “miracle économique libanais” d’antan, ce rôle régional s’est manifesté sous différentes formes d’intermédiation commerciale, bancaire, voire même industrielle entre l’hinterland arabe et le marché international. Il s’est cependant bloqué depuis la fin des années 70. Ce blocage a été induit, d’un côté par les mutations qui ont secoué l’économie libanaise et de l’autre par les bouleversements qui ont remodelé les caractéristiques de l’espace économique arabe durant les trois dernières décennies.
Sous l’effet de ce double phénomène, on a abouti à une constatation évidente : ce rôle régional du Liban, érigé longtemps comme une donnée fixe et immuable, s’est avéré un fait circonstanciel dépendant d’une conjoncture qui a subi des transformations endogènes et exogènes.
Les politiques économiques et les plans de reconstruction élaborés durant la période d’après-guerre ont été implicitement marqués par la nostalgie du rôle d’intermédiation classique joué précédemment par le Liban. Et ce malgré l’impression différente que voulait laisser entendre la littérature développée par les acteurs publics. Cette “nostalgie suffocante” s’exprimait selon la logique suivante : «Sécurité + pouvoir judiciaire + réhabilitation de l’infrastructure + paradis fiscal = croissance durable et reprise spontanée du rôle régional du Liban».
Or, cette logique, assez simpliste et volontariste, ne s’est guère concrétisée. Sur le terrain, les choses étaient beaucoup plus complexes. En fait, les pertes occasionnées par la guerre ont impliqué un retard économique souvent sous-évalué qui ne pourrait être comblé qu’à travers plusieurs générations. Vingt-cinq ans après le déclenchement des hostilités, les résidents au Liban, dont le nombre s’est accru d’environ 80 %, produisent à peine le même PIB qu’en 1974, alors que des pays comparables, à l’époque, ont triplé leur PIB durant cette même période (Chypre, par exemple).
L’explosion
des finances publiques
Outre ces pertes, une nouvelle donne est venue aggraver la redéfinition du rôle régional du Liban. Il s’agit des surcoûts infligés à l’économie par l’explosion des finances publiques, c’est-à-dire du déficit budgétaire, de la dette publique et du service de cette dette qui a impliqué une ponction des revenus des ménages et des entreprises. Devant la gravité de cette question, les instances étatiques sont beaucoup plus préoccupées à contrôler la recrudescence de la dette publique qu’à redéfinir les nouveaux maillons de notre rôle régional. Ces deux objectifs sont en fait étroitement liés. Le problème est de savoir comment utiliser efficacement le facteur temps pour débloquer la situation à ces deux niveaux, sans tomber dans le faux dilemme : sacrifier les objectifs de croissance aux objectifs du contrôle des finances ou vice versa.
C’est dans ces conditions intérieures difficiles que se pose le problème de la redéfinition du rôle régional de l’économie libanaise. Or, il est évident que les conditions extérieures sont aussi complexes sinon plus. Sans prétendre être exhaustif, essayons d’en cerner certains points importants :
• Le Liban ne peut plus être considéré comme une “nécessité économique” pour le monde arabe dans la même optique et les mêmes termes que par le passé. La tendance de plus en plus généralisée – dans la majorité de ces pays – vers l’économie de marché, la privatisation, la libéralisation de l’environnement juridique ont profondément affaibli le pouvoir concurrentiel du Liban. Le Liban est donc appelé à rechercher d’autres créneaux.
• L’achèvement de la majeure partie des travaux d’infrastructure dans ces pays, notamment dans les pays du Golfe, a lui aussi contribué à la contraction du précédent rôle du Liban en tant qu’exportateur de services spécifiques comme les services de transport, de tourisme, de commerce triangulaire, d’éducation, de santé et surtout des services bancaires et financiers. Il en a résulté qu’une bonne partie des services traditionnels libanais n’est plus commercialisable (non tradable services) ni, surtout, exportable. Outre la diminution de la capacité d’exportation de services, la chute du pouvoir d’achat intérieur a eu, lui aussi, les mêmes effets. Donc, même si le secteur tertiaire continue à représenter 65 à 70 % du PIB libanais, il est clair que ses structures internes, son degré de spécialisation, sa disposition à produire une plus grande valeur ajoutée… semblent s’affaiblir et se détériorer.
• Or, les progrès réalisés dans l’espace économique régional ne se limitent pas au domaine des infrastructures. En effet, malgré le rôle toujours prédominant du pétrole, une tendance à la diversification se confirme. L’Arabie saoudite devient exportatrice de produits industriels et agricoles. Bahrein maintient une suprématie reconnue en tant que centre bancaire offshore. Dubaï a enregistré d’énormes progrès en matière de commerce triangulaire, de services bancaires quoique classiques et surtout de services touristiques. En Égypte, la relance économique se confirme et tend à faire de ce pays une plaque tournante pour l’investissement direct étranger. D’ailleurs, plus d’une cinquantaine de groupes industriels et commerciaux libanais se sont déjà partiellement ou totalement délocalisés vers le marché égyptien où les activités boursières tendent, par ailleurs, à s’intensifier. Même la Jordanie, dont les conditions économiques ne sont pas tellement favorables, s’achemine vers la constitution d’un centre hi-tech qui pourrait avoir une dimension régionale. Bien qu’on assiste à une baisse des taux de croissance dans la région, ces différents développements auront un impact significatif sur la redéfinition du rôle régional du Liban.
• De plus, l’espace régional ne se limite pas à sa composante arabe. Plus que jamais, le règlement du conflit israélo-arabe se pose. Tôt ou tard, l’avènement d’une paix dans la région va produire ses effets sur le plan économique. Incontestablement, le Liban aura à relever un défi supplémentaire et de taille. Ce sera sans doute le défi majeur : celui de faire face aux visées et aux ambitions du rôle régional d’Israël. Mieux équipé en ressources humaines et en capital, doté d’une répartition économique sectorielle et d’une structure des importations et exportations bien équilibrée, Israël se trouve manifestement mieux placé – du moins sur le plan économique – que le Liban dans cette “course régionale”. Profitant d’une productivité moyenne et d’un revenu moyen 4 fois plus important que ceux du Liban, Israël sera indéniablement tenté de confirmer sa suprématie économique au niveau de la région. Son avance en matière d’éducation et de recherche scientifique ne pourra que l’encourager dans cette démarche.
Le facteur temps
Une fois de plus, le rôle du facteur temps pour le Liban et les Libanais est primordial. Parallèlement à la priorité qu’il devrait accorder au problème de ses finances publiques, le Liban est appelé à identifier et mettre en cours les conditions propices à la substitution de son ancien rôle d’intermédiation plutôt simple – qui s’est définitivement écroulé – par de nouvelles formes d’intermédiation, plus complexes, plus productives et plus professionnelles. Des changements majeurs doivent être opérés à divers égards : une véritable “révolution” du système éducatif, une intensification des échanges intra et intersectoriels, un vrai mariage entre les secteurs de production (notamment l’industrie et l’agriculture) à des fins exportatrices, une généralisation de nouvelles pratiques technologiques et informatiques, des services plus pointus, un tourisme compétitif…
Ces changements majeurs devraient respecter un ensemble de principes. Les plus importants étant, d’un côté, la résorption des inégalités sociales et la participation de la grande masse aux fruits du développement et, de l’autre, la consécration des libertés publiques et individuelles. Ces deux principes font partie intégrante du processus de construction de la compétitivité du Liban dans le long terme.
C’est à la suite de ces changements que le Liban pourra se frayer un chemin vers un rôle régional moins éphémère et plus efficace.