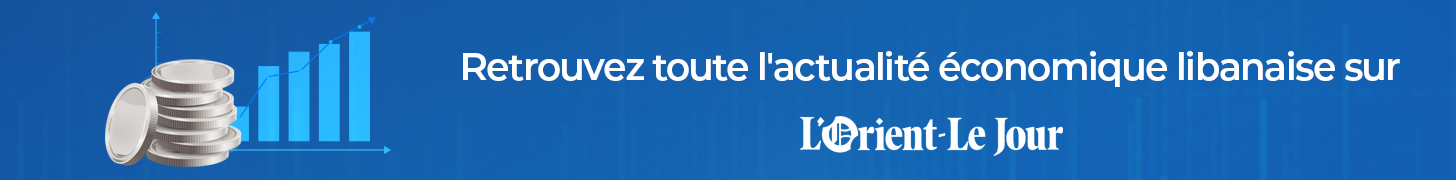Le Liban s’est engagé en signant la convention de Genève en 2006 à passer à la télévision numérique terrestre d’ici à 2015. Mais rien n’a encore été fait : la configuration particulière du paysage audiovisuel libanais rend son déploiement facultatif, alors que la nécessité de revoir entièrement la loi 382 sur l’audiovisuel freine son implantation.

Le terme télévision numérique terrestre définit en fait un mode de transmission des programmes télévisés : comme son ancêtre la télévision analogique, la TNT utilise les fréquences pour transporter l’information (image et son). Mais celle-ci est numérisée (sous forme de 1-0) au lieu d’être analogique (c’est-à-dire continue dans le temps et en amplitude, voir schéma).
Les fréquences font l’objet d’une régulation à l’échelle mondiale par l’Union internationale des télécoms (ITU), afin d’éviter les interférences entre pays. En signant la convention de Genève de 2006, le Liban s’est engagé à passer à la télévision numérique terrestre d’ici à 2015, à l’instar des pays de la zone 2 dont il fait partie (comme l’Europe et l’Afrique). Mais sur le terrain, rien n’a encore été fait.
L’Autorité de régulation des télécoms (ART), en charge de la gestion des fréquences, a lancé une consultation en 2008 auprès des acteurs du secteur, sans recevoir le feedback voulu : à l’époque, seule une chaîne de télévision avait répondu.
Poussé par l’approche de l’échéance, le ministère des Télécoms a relancé le débat fin 2011, sur la base de la recommandation proposée par l’ART en 2008. « Nous sommes déjà très en retard, explique Imad Hoballah, président par intérim de l’ART. Nous devrions commencer maintenant si nous voulons être dans les temps. » Fin avril, le Conseil des ministres a approuvé la formation d’un comité pour piloter le dossier. Il sera formé par des représentants des ministères des Télécoms et de l’Information, du Conseil de l’audiovisuel et de l’ART. « Il a pour objectifs de débattre avec le secteur privé de l’intérêt de la mesure et de présenter son rapport aux deux ministères concernés d’ici à deux mois », explique Gaby Daniel, conseiller en charge du dossier au ministère des Télécoms.
Mais les chaînes de télévision locales, pas encore consultées, traînent la patte, par manque de motivation. On estime en effet que 95 % des foyers libanais reçoivent la télévision via le satellite (qui transmet des images numériques), légal ou illégal ; ils ont ainsi accès à plus d’une centaine de chaînes régionales et internationales, en plus des neuf chaînes locales gratuites. Les réseaux terrestres analogiques sont donc très peu utilisés, lorsqu’ils existent : les chaînes OTV et MTV, qui ont une licence terrestre, ne diffusent que par satellite. Ce qui signifie qu’en 2015, « si nous décidons d’éteindre les fréquences analogiques, seuls 5 % des foyers libanais n’auront plus accès à des programmes télévisés », explique Gaby Daniel.
L’enjeu économique du passage à la transmission terrestre numérique est donc à étudier. « Toute cette histoire est un peu dépassée », estime Pierre el-Daher, PDG de la LBCI. En revanche, il existe pour le gouvernement un enjeu citoyen : « La transmission est un droit pour tous ; le ministère doit faire en sorte que les 5 % des foyers qui aujourd’hui reçoivent les chaînes gratuites via leur antenne analogique puissent continuer à y avoir accès si nous passons (ou pas) au numérique. » Il existe également un enjeu sécuritaire : « À partir de 2015, nos fréquences analogiques ne seront plus protégées, et nous ne pourrons pas recourir à l’ITU si nous souffrons d’interférences à nos frontières, explique Gaby Daniel. La loi de la jungle veut en outre que si nous n’utilisons pas nos fréquences numériques, nos voisins vont le faire. » Le Liban a donc entamé les démarches nécessaires auprès de l’organisation internationale pour les protéger.
Le modèle des chaînes privées remis en question
Aujourd’hui, chaque chaîne de télévision libanaise qui émet sur les ondes terrestres analogiques possède son propre réseau, composé d’antennes et d’émetteurs, et a à sa disposition quatre fréquences lui permettant de remplir une obligation légale de couverture totale du territoire. Ce que peu d’entre elles font en réalité. Le passage au numérique, en compressant les données, réduit le nombre de fréquences nécessaires à la transmission : une seule fréquence peut alors transmettre les programmes de plusieurs chaînes. L’ART recommande dans sa proposition de 2008 de loger quatre à cinq chaînes de télévision sur chaque fréquence numérique, en fonction du degré de compression des informations. « Deux fréquences, donc un ou deux réseaux, suffiraient pour répondre aux besoins des chaînes existant au Liban », confirme Imad Hoballah. « L’État pourra exercer un meilleur contrôle sur la santé publique et sur les interférences (notamment pour l’Aviation civile), en maîtrisant le niveau de puissance des antennes », commente Gaby Daniel. Les chaînes devront investir pour changer leurs équipements de transmission, mais cette charge sera plus que compensée par la réduction du coût d’entretien des réseaux, estimé à 1,5 million de dollars par an par la LBCI. Le ministère avance un chiffre préliminaire d’investissement de 50 millions de dollars pour construire ces réseaux numériques ; ce chiffre comprend le coût de construction, d’équipement et de maintenance des sites, les subventions aux décodeurs à installer sur les télévisions libanaises, en majorité analogiques, et les campagnes d’information du public.
Dans le monde, un des intérêts du passage à la TNT a été de libérer des fréquences pour que d’autres télévisions, gratuites ou payantes, puissent entrer sur le marché. « En France, nous sommes passés de six chaînes gratuites à 18 (NDLR : à 24 d’ici à fin 2012) », témoigne François Desnoyers, ancien directeur général délégué aux antennes et directeur de la communication de Radio-France. Au Liban, on peut imaginer que les chaînes lanceront des chaînes thématiques (sport, films d’action, etc.), ce qui leur permettrait d’augmenter leurs revenus publicitaires, note Gaby Daniel. Mais il n’est pas dit que le marché, relativement petit, puisse et soit intéressé de financer des chaînes supplémentaires. Cela peut néanmoins être l’occasion pour les télévisions existantes de passer en haute définition, ce que leurs consœurs arabes ont commencé à faire.
La mise en place de ce ou ces deux réseaux communs pose une problématique de mode d’implantation et de gestion communes entre les différentes chaînes. Les réseaux appartiennent-ils à l’État ou à un investisseur privé ? À qui la gestion des réseaux revient-elle ? Est-il envisageable de penser que les chaînes de télévision créeront une structure commune chargée de la gestion du réseau, de laquelle ils loueraient la capacité de fréquence nécessaire ?
Un paysage à nettoyer
D’un point de vue réglementaire, le passage au numérique permettrait de nettoyer le paysage audiovisuel libanais et de prendre en compte son aspect satellitaire illégal. Le dernier rapport sur la propriété intellectuelle estime que 900 000 foyers du pays du Cèdre sont connectés illégalement à la télévision, « soit pratiquement tout le Liban », ironise Mohammad Ayoub, de l’ART. Le chiffre de 5 000 familles vivant de ce marché illégal de la télévision et d’Internet est avancé. Quelque quatre sociétés légales de transmission satellitaire existent : Cable Vision, Econet, Digitech (qui opère surtout au Mont-Liban),et CityTV (qui n’est pas en fonction) ; elles n’ont qu’une toute petite part de marché, étant plus chères (15 dollars par mois) que leurs concurrentes illégales (10 dollars par mois d’habitude) qui ne paient pas de taxes. « Le passage au numérique implique de nettoyer les fréquences, sur lesquelles ces sociétés interfèrent, et d’essayer de les intégrer dans un schéma national », commente Gaby Daniel. Selon Sylvain Anichini, expert international dans le déploiement des outils de télévision et de radio et ancien directeur général adjoint à Radio-France chargé des techniques et technologies nouvelles, « le passage au numérique est un véritable projet national, ne serait-ce que parce qu’il rassemble tous les acteurs autour de la table ».
En soi, il n’est pas obligatoire de construire un réseau terrestre numérique : le territoire libanais est déjà bien couvert par satellite, et le déploiement en cours de fibre optique est théoriquement prévu pour permettre dans le futur la transmission de la télévision via les câbles, aux côtés de l’Internet et de la téléphonie fixe (ce qu’on appelle le Triple Play). Si l’État décide de se passer de la TNT, « il devra subventionner l’accès aux chaînes gratuites pour les plus pauvres (un décodeur coûte dans les 60 dollars) et s’assurer que les distributeurs de télévision par satellite leur fournissent le service », commente Imad Hoballah.
La question essentielle qui se pose est celle de la gestion des fréquences libérées : « La tendance mondiale va vers une utilisation croissante du spectre de fréquences pour les données mobiles (3G et 4G), qui augmentent de manière exponentielle. Il est donc urgent de mettre en place un plan au Liban afin de préserver les fréquences destinées à cet usage », explique le président par intérim. La valeur économique du spectre est loin d’être négligeable. Aujourd’hui, l’État perçoit une redevance annuelle sur les licences, soit 100 millions de livres libanaises par chaîne télévisée ; s’il décidait d’allouer les 32 fréquences libérées à des services mobiles, et en fonction du mode d’allocation (licences ou non), il pourrait gagner beaucoup plus : en France, « le passage au numérique a coûté 100 millions d’euros à l’État, a libéré les fréquences pour les données mobiles et lui en a rapporté 1,8 milliard lors des appels d’offres pour la 4G », témoigne Sylvain Anichini.
Une remise en cause de la loi
Le ministère se donne jusqu’à l’été pour décider de la partie technique du plan. « La modification de la loi, indispensable au projet, risque de prendre plus de temps », commente Gaby Daniel. Les télévisions libanaises sont régies par la loi 382 sur l’audiovisuel datant de 1994, qui a été conçue pour les télévisions analogiques. Elle lie la licence d’émission aux fréquences. Or, aujourd’hui, la fréquence n’est plus qu’un moyen de transmission des programmes, qui rentre en concurrence avec le satellite et le câble Internet. « Il faut revoir la loi 382 et séparer la licence d’émission et la transmission », affirme Mohammad Ayoub. L’objectif étant que les chaînes aient alors une licence pour émettre et louent de la capacité sur le moyen de transmission qui leur convient le mieux. Cela impliquerait de revoir également la loi 531, qui régit la transmission par satellite. « Il faut intégrer l’audiovisuel dans la loi sur les médias en général », ajoute-t-il.
Pour Imad Hoballah, le passage au numérique est « l’occasion de libéraliser le marché, de remettre le Liban sur la scène médiatique arabe, pour que les studios de production reviennent s’installer ici. Par exemple, la station de Jouret el-Ballout nous permet de capter les chaînes étrangères (surtout arabes) et les réémettre sans modification vers les satellites NileSat et ArabSat en les intégrant dans des bouquets avec des chaînes libanaises. Si nous changions la loi pour autoriser le montage et y intégrer des programmes avant de réémettre, nous pourrions recréer une véritable industrie ». Hoballah suggère également que l’argent retiré de la libération des fréquences pourrait permettre de financer un satellite libanais. « Les chaînes libanaises pourraient émettre d’ici, la chaîne de valeur serait entièrement maîtrisée localement, et cela créerait des emplois », argumente-t-il. Pierre el-Daher est cependant sceptique : « Un satellite libanais coûterait dans les 250 millions de dollars, je doute qu’on puisse réunir autant de fonds. »
Trois modes de transmission possibles
La transmission de contenu audiovisuel numérique peut se faire par trois moyens différents : des ondes hertziennes, le câble Internet, ou par satellite. « Lorsqu’on bâtit la partie technique d’un paysage télévisé, il faut prendre en compte les trois modes de transmission, commente Sylvain Anichini, car les situations de réception sont différentes. »
Les ondes terrestres sont très efficaces en termes de coût et constituent en général la solution la plus économique pour desservir rapidement toute une zone.
Le câble Internet est relativement cher à mettre en place et prend plus de temps. Le coût de la réception télévisée pour l’utilisateur est masqué dans son abonnement Internet. La réception n’est plus anonyme, contrairement aux ondes, ce qui pose des problèmes de protection de la vie privée.
Le satellite, moyen de transmission privilégié au Liban, est l’arme absolue pour couvrir tout un territoire en une fois. La location de fréquences sur les satellites internationaux est très chère, ce qui explique que les chaînes de télévision s’y tournent en dernier recours ; mais au Moyen-Orient, le prix de cette location est raisonnable. « À titre d’exemple, une fréquence sur NileSat coûte 250 à 300 000 dollars par an », commente Gaby Daniel. Le prix d’un décodeur pour satellite est également moins cher au Liban qu’en Europe : 60 dollars versus 200 euros (260 dollars environ).
Les ondes terrestres sont très efficaces en termes de coût et constituent en général la solution la plus économique pour desservir rapidement toute une zone.
Le câble Internet est relativement cher à mettre en place et prend plus de temps. Le coût de la réception télévisée pour l’utilisateur est masqué dans son abonnement Internet. La réception n’est plus anonyme, contrairement aux ondes, ce qui pose des problèmes de protection de la vie privée.
Le satellite, moyen de transmission privilégié au Liban, est l’arme absolue pour couvrir tout un territoire en une fois. La location de fréquences sur les satellites internationaux est très chère, ce qui explique que les chaînes de télévision s’y tournent en dernier recours ; mais au Moyen-Orient, le prix de cette location est raisonnable. « À titre d’exemple, une fréquence sur NileSat coûte 250 à 300 000 dollars par an », commente Gaby Daniel. Le prix d’un décodeur pour satellite est également moins cher au Liban qu’en Europe : 60 dollars versus 200 euros (260 dollars environ).
L’inéluctable passage au numérique
Le parc libanais des téléviseurs est ancien. Les postes sont équipés pour une réception analogique. Pour recevoir des programmes via une transmission terrestre numérique ou satellitaire, les téléspectateurs doivent installer un décodeur. Le renouvellement du parc, qui se fait de manière progressive, passe par l’achat de nouveaux téléviseurs à écran plat, qui sont tous numériques : « À ma connaissance, il n’y a plus d’usines de fabrication de tubes cathodiques, nécessaires aux télévisions analogiques, dans le monde, à part peut-être en Chine et en Turquie », explique Sylvain Anichini, expert international dans le déploiement des outils de télévision et de radio. Par ailleurs, la production de contenu audiovisuel est réalisée en numérique dans le monde (et au Liban) depuis de nombreuses années. Le passage à la transmission numérique, qu’elle soit satellitaire, hertzienne ou câblée, est donc une suite logique, afin de bénéficier de la meilleure qualité d’images possibles.
Les télévisions libanaises
Au Liban, dix licences ont été attribuées à des chaînes de télévision qui donnent droit à quatre fréquences chacune.
• Télé-Liban (la télévision publique a deux licences, car elle est née de la fusion de deux chaînes)
• NBN
• Future TV
• MTV (qui émet par satellite
uniquement)
• LBCI
• Manar
• New TV
• ICN (ella a fermé)
• OTV (qui émet par satellite
uniquement).
Il faut ajouter à cette liste Télé Lumière qui n’a pas de licence et émet par satellite.
• Télé-Liban (la télévision publique a deux licences, car elle est née de la fusion de deux chaînes)
• NBN
• Future TV
• MTV (qui émet par satellite
uniquement)
• LBCI
• Manar
• New TV
• ICN (ella a fermé)
• OTV (qui émet par satellite
uniquement).
Il faut ajouter à cette liste Télé Lumière qui n’a pas de licence et émet par satellite.