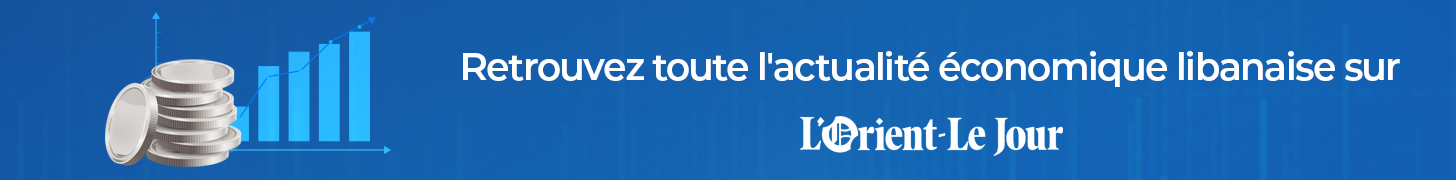C’est la première étape… et la plus ingrate. Mais c’est un passage obligé que de choisir
un type de société et noircir la paperasse correspondante.
Inspiré du droit commercial français, le droit commercial libanais retient six types de sociétés : la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple, la société en participation, la société anonyme (SA ou SAL), la société en commandite par action et enfin la société anonyme à responsabilité limitée (SARL). Comment effectuer le bon choix ?
Le succès de la SARL
Généralement, le choix s’opère en fonction du genre d’activité. Par exemple, pour un petit commerce, une production artisanale, une fabrique de textiles, on peut opter pour la SNC, la commandite simple ou la SARL. Quelle est la différence entre ces trois types de sociétés ?
La SNC et la commandite simple sont considérées comme des sociétés de personnes : les associés sont en nombre limité et se connaissent les uns les autres.
SNC
• Deux ou plusieurs associés (associés en nom).
• Ils engagent tout leur patrimoine : si la société fait faillite, les associés sont mis en faillite.
Commandite simple
• Un ou plusieurs “commandités” (associés qui gèrent).
• Plusieurs “commanditaires” (associés qui financent).
• Les commandités engagent leur patrimoine : responsabilité absolue.
• Les commanditaires ont une responsabilité limitée à leurs apports.
SARL
La SARL est constituée par un nombre d’associés qui va de deux jusqu’à vingt (ou plus en cas d’héritage).
• Ils ne sont responsables des dettes de la société qu’en fonction de leur contribution.
• Leurs actions ne peuvent être librement négociées (cédées à des tiers).
La SARL est adéquate pour ceux qui désirent entreprendre des activités à petite échelle. Au Liban, les PME ont, dans leur presque-totalité, opté pour la SARL qui, malgré certains désavantages, offre plus de liberté qu’une SNC ou une commandite simple. De fait, les associés n’ont qu’une responsabilité limitée à leurs apports comme pour la SA. En outre, la faillite de l’un d’entre eux n’entraîne pas la décomposition de la société.
Sociétés de capitaux :
la SAL l’emporte
Au cas où on décide d’investir dans une activité de grande envergure (industrie, services, grande distribution, etc), la SAL est le type par excellence de sociétés de capitaux à choisir. La commandite par action en est le deuxième type, bien que rarement adoptée au Liban.
SAL
• Plusieurs associés (actionnaires).
• Détenteurs de titres (actions) négociables.
• La responsabilité est limitée à la contribution représentée par les actions.
Commandite par action
• Deux ou plusieurs commandités (associés qui gèrent).
• Plusieurs commanditaires dits actionnaires (associés qui financent).
• Les commandités engagent tout leur patrimoine. Ils ont une responsabilité absolue. S’ils sont en faillite, la société se décompose.
• La responsabilité des commanditaires est limitée à leur contribution.
Dans le cas de la SAL, la souscription peut être ouverte au grand public : tout le monde peut y participer, l’action ayant généralement une valeur peu élevée. Par conséquent, le nombre de détenteurs d’actions varie et il peut y avoir une injection d’argent frais. Ce qui permet l’investissement dans de gros projets. Qui plus est, l’action est un titre négociable. Elle est donc librement cessible. Au Liban, toutes les grandes compagnies, à quelques exceptions près, sont des SAL. 2 Maîtriser le jargon de base L’entrepreneur n’est pas nécessairement un économiste. Mais au moins devrait-il assimiler les 5 chiffres basiques s’il veut absolument gagner de l’argent ?
La performance de l’entreprise est mesurée et suivie avec deux grandes catégories d’indicateurs : les indicateurs économiques d’une part, les indicateurs physiques de l’autre. Nous traiterons ici des principaux indicateurs économiques utilisés dans les entreprises libanaises, de leur définition, de leur mode de calcul et de leur signification.
Le chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est le total des factures émises par l’entreprise en contrepartie de la fourniture de produits ou de services. Cela inclut aussi les factures d’outillages, de prototypes ou de services. En revanche, cela ne comprend pas les redevances et revenus financiers.
Le chiffre d’affaires mesure le volume d’activité de l’entreprise.
La marge brute
La marge brute est ce qui reste quand on enlève du chiffre d’affaires les dépenses de fabrication (achats de production, frais généraux de production, main-d’œuvre directe et indirecte de fabrication, amortissement des investissements de fabrication). On exprime souvent la marge brute en pourcentage par rapport au chiffre d’affaires. Elle permet de mesurer à la fois la performance de production et la performance d’achat.
C’est un indicateur de notre bonne adaptation au marché.
Le résultat courant
Mais l’entreprise supporte d’autres charges que les frais de fabrication : frais commerciaux, administratifs, frais d’études et de recherches, publicités, frais et produits financiers. C’est en déduisant ces frais de la marge brute que l’on obtient le résultat courant.
Là encore, en exprimant le résultat courant en pourcentage du chiffre d’affaires, on peut évaluer l’efficacité globale de l’entreprise.
Le résultat net
Deux catégories de charges restent à déduire du résultat courant pour obtenir le résultat net, ou encore le profit. Elles sont extérieures au fonctionnement courant de l’entreprise. Il s’agit des charges exceptionnelles (par exemple des équipements obsolètes à détruire, des frais de licenciements occasionnés par des événements exceptionnels) et des taxes et impôts.
Il faut également ajouter d’éventuels produits exceptionnels (cessions d’actifs par exemple). Naturellement, si la marge brute ou le résultat courant constituent des indicateurs de la performance de l’entreprise, l’objectif final est bien d’obtenir le plus grand résultat net possible.
La trésorerie
La trésorerie est la somme présente à un moment donné sur les comptes bancaires de l’entreprise. La trésorerie ne se déduit pas directement des éléments ci-dessus, en raison de différents mécanismes. Par exemple, une facture envoyée à un client vient augmenter le chiffre d’affaires et en cascade tous les éléments qui en découlent. En revanche, elle ne change rien dans l’immédiat à la trésorerie, qui ne sera modifiée que le jour où le client paiera la facture. S’il le fait. Inversement pour une facture reçue d’un fournisseur et qui se verra comptabiliser en charge (de production ou autre) : son montant ne viendra en déduction de la trésorerie que le jour où le fournisseur sera payé. D’où l’importance de la notion de délais de paiement. Chacun peut continuer à améliorer les délais de paiement en fournissant un service irréprochable au client. La qualité des produits et du service apporté au client permet qu’il règle plus rapidement la facture et donc améliore la trésorerie de l’entreprise.
Autre exemple important, celui des investissements : quand une entreprise achète une nouvelle machine, il ne s’agit pas là d’une dépense d’exploitation. L’argent est bien dépensé (diminution de la trésorerie), mais les comptes de charges ne se verront augmentés qu’au rythme des amortissements de la machine (somme annuelle représentant l’usure de la machine prévue par les règlements comptables et fiscaux).
Ces raisons, entre autres, expliquent le décalage quelquefois important qui peut exister entre le résultat net de l’entreprise et sa trésorerie à un moment donné.