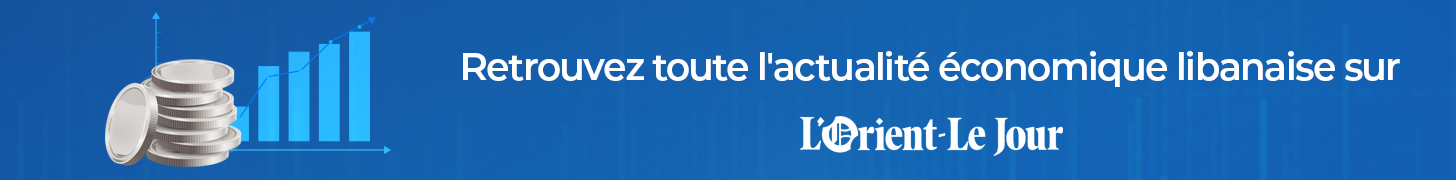Achèteriez-vous un Dior, nécessairement de bonne qualité, si personne ne sait – ou saura – que c’est un Dior ? La psychosociologie du luxe a de ces pièges…
Ostentation, comme le latin “ostentio”,
est “l’action de montrer aux yeux de
tous”. Autant dire avec insistance.
C’est ce que la “consommation ostentatoire”
recoupe en tout cas comme concept. Elle
s’opère pour une raison de valorisation sociale,
sans qu’il y ait nécessairement un intérêt
fonctionnel à la chose.
Maigre consolation, le phénomène est historique.
On raconte même que dans l’Empire
romain, l’ancienne aristocratie perdit au
moment de la décadence une bonne part de
son prestige au profit d’une nouvelle classe
sociale, bourgeoise avant la lettre, et n’avait
plus alors pour asseoir sa légitimité et sa distinction
que le raffinement ostentatoire et la
démesure, devenue légendaire.
Comme le suggèrent aussi d’autres exemples
historiques, la consommation ostentatoire est
depuis toujours enracinée dans la dynamique
sociale. Et l’on continue à acquérir ces produits
ou services, symboliques, dans le but
d’envoyer des signaux que la population environnante
va capter et déchiffrer. Certains en
arrivent donc à assimiler la consommation
ostentatoire aux produits dits de luxe. Ceci est
vrai, même si ce n’est pas toujours le cas. La
consommation ostentatoire ne se limite pas à
ces produits ; et les produits de luxe ne sont
pas tous considérés comme ostentatoires.
Comment alors décortiquer ces paradoxes ?
En fait, psychologie élémentaire, les produits
ou services luxueux sont supposés révéler un
peu – beaucoup – qui nous sommes. Par
exemple, acheter un sac Louis Vuitton avec
son logo bien visible consiste à lancer un message
d’appartenance à une certaine classe
sociale qui peut se permettre – et apprécie –
un Louis Vuitton. Mais l’on apporte quelque
nuance à ce type de signal. Exemple, l’achat
d’un sac Hermès ou d’un Montblanc plus discret
véhicule toujours une image de luxe, mais
moins voyante. Au risque parfois de passer
inaperçu ! Par exemple, la réduction du logo
de Chanel en 1998 a eu des effets dommageables
sur les ventes de Chanel dans certains
pays. La marque a dû donc réintroduire
une collection avec un logo bien visible l’année
suivante.
TOUS À LA MÊME ENSEIGNE ?
Mais quels sont les groupes sociaux qui ont le
plus souvent de comportements ostentatoires
dans leur consommation ? Plusieurs sont
concernés, quoique d’une façon différenciée :
il y a d’abord ceux qui veulent montrer leur
réussite ou ascension sociale en consommant
des produits luxueux ostentatoires ; autre
variante, on retrouve les “nouveaux riches”,
qui tendent à montrer ce qu’ils ont acquis,
d’autant plus que leur richesse n’était pas
méritée ; puis, il y a ceux qui, même avec peu
de moyens, se procurent quand même de tels
produits afin d’émuler une classe sociale
immédiatement supérieure ; et enfin, bien
sûr, ceux qui cherchent à asseoir leur position
sociale dans le groupe d’appartenance actuel.
La mode représente l’exemple type des produits
de luxe ostentatoires. Nous remarquons
par exemple une prolifération croissante
depuis quelques années des boutiques de
luxe dans le pays. Le chiffre d’affaires d’Aïshti
frôle les 50 millions $ par an et représente
déjà l’un des plus gros clients de Gucci à l’international.
Mais le business du luxe se trouve aussi coincé
entre 2 soucis contradictoires : il doit, par
définition, rester élitiste, distinctif, exclusif ;
mais, en même temps, il doit atteindre un
seuil de ventes minimal pour rentabiliser l’investissement.
Certaines marques de luxe préfèrent
ne jamais solder leur produit, comme
par exemple Louis Vuitton. D’autres vendront
leurs fins de série dans les boutiques dégriffées.
Ceci dit, rares sont les exemples où le produit
ne remplit qu’une fonction purement
visible, mais non utilitaire. On inclut dans
cette catégorie les bijoux. En revanche,
tout produit de luxe n’est pas forcément
ostentatoire : comme un très cher cigare
cubain qu’on achète pour fumer chez soi. Il
en va de même, dans cette catégorie de
luxe “discret”, d’un set de lingerie fine
qu’on achète à 2 000 $ mais qui ne sera
pas visible – sauf disons à quelques privilégiés.
Enfin, exemple ultime, les amateurs
d’art qui achètent un tableau de maître à
plusieurs millions de dollars, sans jamais
oser l’accrocher dans le séjour…
de recherches et d’études doctorales (CRED) de
l’ESA.