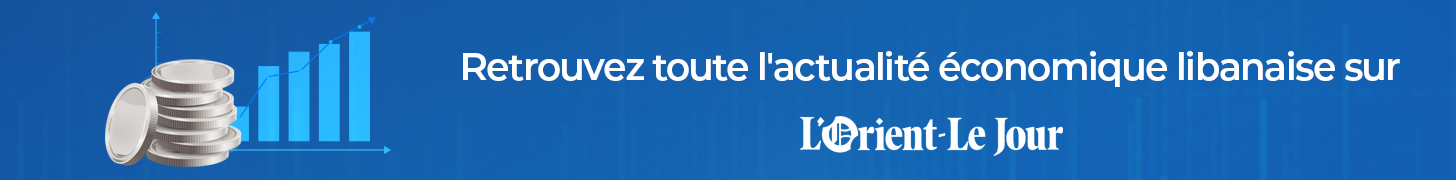La structure bicéphale de l’industrie vitivinicole libanaise est l’héritière de l’histoire foncière du Liban. Comme dans d’autres régions, les Ottomans ont favorisé la création de grandes propriétés dans la Békaa, qui perdurent toujours pour certaines. Ces grands propriétaires libanais sont aujourd’hui quasiment les seuls en mesure d’investir sur le long terme dans la constitution d’un vignoble.

Lamia Maria Abillama
Mais dans la seconde moitié du XIXe siècle, la Sublime Porte décide de mettre en œuvre une réforme agraire et foncière. Les autorités veulent moderniser les structures socio-économiques et cadastrer les possessions des uns et des autres de manière définitive afin de mieux définir son assiette fiscale. Au départ, ces réformes partent d’un bon sentiment : il s’agit d’encourager l’appropriation foncière aussi bien par les familles pauvres que les familles riches, du littoral ou du Mont-Liban. Mais le résultat est bien différent : les grands notables se taillent la part du lion dans la Békaa. « De grandes propriétés privées (ont pu se constituer) lorsque les chefs de tribu ou de clan, les notables ou les chefs de village “mouchaa” (des terres publiques à usage collectif, NDLR) firent enregistrer ces terres comme biens personnels », lit-on dans une revue de l’IFPO.
Derviche Pacha, ancien gouverneur de Damas, possédait une propriété de 1 540 hectares – soit cinq villages – tout autour de Anjar qu’il avait “acquise” en payant les taxes des paysans dans l’incapacité de faire face à leurs obligations fiscales. Il en sera par la suite exproprié par les Français qui y installent les réfugiés arméniens du Sandjak d’Alexandrette. « Lorsque les petits propriétaires n’arrivaient pas à payer les taxes foncières et fuyaient la terre, il suffisait que des notables payent les impôts à leur place et la propriété leur était transférée. Enfin, de petits propriétaires endettés ont cédé leur propriété à des notables qui les protégeaient. »
La situation ne change guère sous le mandat français : elle s’accentue au contraire. Entre 1860 et 1920, la petite propriété disparaît presque complètement dans cette région de la Békaa-Ouest et Nord au profit des grands propriétaires ou des usuriers qui rachètent les terres. « La réorganisation cadastrale pratiquée au Grand Liban était pire que ce que l’on imaginait, car elle a constitué le droit de propriété non pas d’après la répartition du travail, mais d’après les défectuosités ottomanes », souligne ainsi le juriste français Louis Cardon, dans “Le régime de la propriété foncière au Liban”. Cette région, entre Mansoura, Kefraya et Kab Élias, détient les principales ressources hydrauliques de la Békaa. Elle attire donc la bourgeoisie commerçante beyrouthine, qui en achète de grandes parcelles et choisit souvent de rester en indivision pour ne pas avoir à en dépecer les surfaces.
À défaut de réforme agraire, les grands propriétaires de la Békaa sont aujourd’hui les seuls à pouvoir se prévaloir d’un espace agricole suffisamment vaste pour permettre la rationalisation du travail. À défaut d’une réforme des baux agricoles, ils sont aussi les seuls à pouvoir envisager des cultures sur le long terme à l’image de la vigne, qui nécessitent un amortissement sur plusieurs années.