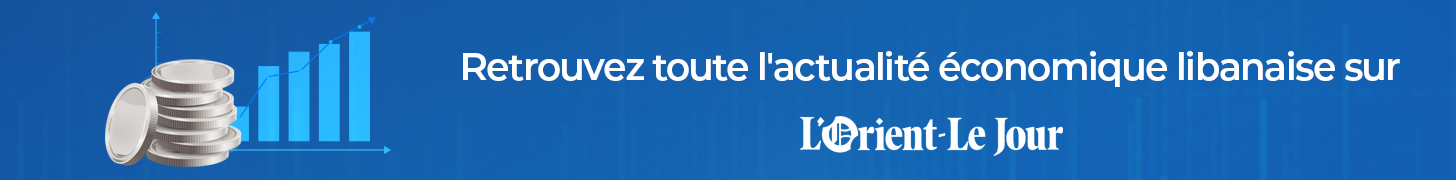Pourtant, ce n’est pas tant l’événement lui-même qui intéresse Mroué que ce qu’il en reste : des archives, comme en attente d’un spectateur improbable pour lui trouver du sens. Découpées, sans texte pour support et soigneusement encadrées, ces miniatures évoquent une énigme, la trace de quelque chose qui eut, peut-être, un temps, un sens, aujourd’hui disparu. « Je ne suis pas intéressé par l’idée de “raconter” la guerre, davantage par celle de la “penser” », avance l’artiste dans un reportage d’Arte pour expliciter son rapport à l’art et à l’histoire.
Parmi les autres œuvres présentées ici, on retient “The Pixelated Revolution”. Mroué y rejoue les quelques secondes qu’il faut à un sniper de l’armée syrienne pour localiser le civil en train de le filmer avec son smartphone et le tuer. Un “double shooting” entre le sniper et le vidéaste amateur. On croirait la séquence “véridique” à l’image de toutes ces vidéos amateurs qui composèrent cette “révolution Facebook” des premiers temps du printemps arabe.
Si les Occidentaux y ont vu une technologie de libération, il ne fallut pas longtemps pour que ces images incarnent aussi le mensonge et l’horreur : vidéos glaçantes de corps démembrés, de tortures, de tueries, de bombardements aveugles… Autant d’images invérifiables, qui disent aussi cet “écho”, ces “traces”, après lesquelles Rabih Mroué semble éternellement courir.
Galerie Sfeir-Semler, jusqu’au 29 juillet, www.sfeir-semler.com