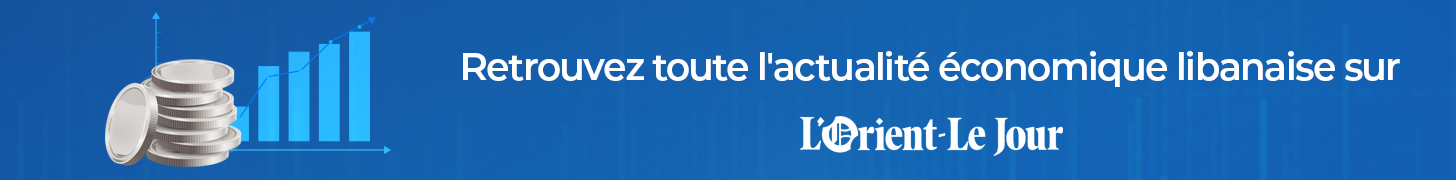Au Liban, vous avez de plus en plus de chance de trinquer avec un verre à pied au lieu de l’arak traditionnel ou du whisky ! Il y a vingt ans, la consommation de vin dans le pays était d’un quart de bouteille par habitant et par an. Aujourd’hui, « on va dépasser les deux bouteilles par habitant et par an », estime Henri Debbané, directeur de la cave à vins Enoteca. Selon les estimations de différents spécialistes, le chiffre d’affaires des producteurs libanais (vente locale et exportation) serait de 31 millions de dollars. Si l’on ajoute les 8,3 millions de dollars (source : douane) générés par les importations de vin étranger, l’on arrive à un marché estimé à près de 40 millions de dollars.
Impossible de passer à côté de l’augmentation de la production vinicole : de cinq millions de bouteilles début 2000 à sept millions estimés aujourd’hui (les chiffres ne sont pas actualisés depuis 2005 par l’Union vinicole du Liban). Ni du nombre de domaines viticoles qui ont fleuri sur un terroir porteur : de cinq à six producteurs “historiques” sur le marché dans les années 1990, on en dénombre maintenant plus de 20 et bientôt une trentaine si toutes les caves en gestation se lancent comme prévu. Selon le recensement effectué en 2000 par le ministère de l’Agriculture, les surfaces consacrées à la vigne couvraient 11 419 hectares, soit 4,61 % de la surface agricole utile (SAU). Ce chiffre cependant ne distingue pas entre vignobles consacrés à l’arak et ceux dédiés à la production de vin. Le rapport du ministère de l’Agriculture évoque cependant une production se répartissant entre 60 % d’arak et 40 % de vin. Soit entre 2500 et 3000 hectares consacrés à la seule culture de la vigne. S’il reste encore réduit, le vignoble s’agrandit depuis les années 2000. « Il se plante près de 100 à 150 hectares par an », explique Maya Trad, de la société Gédéon et Trad, qui est l’agent de marques françaises et espagnoles au Liban et importe tout le matériel nécessaire à la vinification. La Békaa concentre toujours l’essentiel de la production (une part de 79 % en 2000 selon le ministère de l’Agriculture), mais d’autres régions émergent comme Batroun, dont le potentiel était inexploité jusqu’en 2000, et où aujourd’hui sept domaines sont présents. Au total sur l’ensemble du Liban, avec 3 000 plants de vigne par hectare, on atteint les 450 000 pieds plantés par an. Ce qui représente une récolte de 7 000 tonnes de raisin par an.
Ce regain d’intérêt pour le vignoble libanais s’explique d’abord par l’investissement affectif des hommes ou des femmes. Une “passion” de la terre ou du vin, qui dessine en filigrane une volonté de “retourner” à ses racines ou “de laisser une trace” dans l’histoire de son pays. « Il faut de l’orgueil pour faire un bon vin. Un homme poussé par une vision intérieure. Peut-être même de la folie », explique Bernard Burtschy, chroniqueur vin au Figaro, tandis qu’il visite le vignoble libanais. Cette vision, c’est celle, par exemple, de Naji et de Jill Boutros, revenus à Bhamdoun, sur les terres de la famille Boutros, alors que le village portait toujours les très lourds stigmates des massacres entre chrétiens et druzes. « Je voulais reconstruire mon village. Faire quelque chose pour les miens », explique Naji Boutros. Ancien de Merrill Lynch et de Colony Capital, Naji Boutros a tout quitté pour réaliser son rêve : voir renaître sa région. C’est aussi l’histoire de Jean et de Mirna Massoud, propriétaires du domaine d’Atibaia, près de Batroun, dont le goût du vin les a poussés à acheter des terrains, à planter, puis à se doter d’une cave pour produire un vin de garage (voir lexique) qui s’annonce prometteur. « Ce domaine, c’est mon troisième enfant. Je le porte en moi. Je n’ai pas investi dans l’espoir d’un retour financier, mais pour des raisons sentimentales », répète Jean Massoud, en contemplant ses vignobles, à flanc de coteaux, coincés entre les oliviers et les chênes liège des collines de Batroun.
Mais cette histoire d’amour entre l’homme et la terre ne doit pas faire oublier que la vigne est aussi une affaire de placement. Le vignoble s’avère en particulier un excellent moyen de faire fructifier des terrains agricoles, sans grande valeur jusqu’à ce que cette culture à forte valeur ajoutée ne vienne en accroître le prix estimé. Le phénomène prend une autre ampleur quand l’appétit de grands groupes financiers s’en mêle. Le phénomène n’est pas libanais. Il est planétaire. Mais il touche aussi Beyrouth. Pour preuve, les derniers projets de cave comme Marsyas, celui des frères Saadé, qui ont investi quelque 25 millions de dollars pour créer leur vignoble dans la Békaa. Ou, plus récent encore, celui qui associe le groupe Debbané à Carlos Ghosn pour un montant resté confidentiel. Derrière, un enjeu de taille : voir leur vin reconnu parmi les meilleurs du monde. Si possible rapidement. De là à parler de “danseuse” ? D’une sorte de caprice de riche, heureux de jouer les gentlemen-farmers le week-end ? « Le vin devient un investissement. Mais certains oublient un peu vite qu’un vignoble ne se rentabilise pas sur cinq ans. Plutôt sur trente. C’est beaucoup de travail », avance Bernard Burtschy. De Francis Ford Coppola (dont le domaine Rutherford, au cœur de la vallée de Napa, Californie, est suivi par l’étoile montante de l’œnologie mondiale, Stéphane Derenoncourt, qui conseille également Marsyas au Liban) à Olivier et Martin Bouygues propriétaire depuis 2006 du château Monrose (France), un second cru classé du Médoc, les exemples sont légions. Pour ces as du showbiz ou de la finance internationale, le vin est certes une passion. Mais il s’agit aussi d’une stratégie de diversification. L’on gère alors sa cave comme on placerait un portefeuille d’actions. Cela fonctionne à condition de penser grands crus. Soit des vins pour lesquels la demande mondiale dépasse la production… Un effet de rareté qui explique l’engouement notamment sur les Bourgognes dont la production s’avère vingt fois inférieure à celle des Bordeaux. Romanée-Conti (Bourgogne) produit ainsi 5 000 bouteilles par an contre 150 000 pour Château Latour (Bordeaux). Le Liban est encore loin de ce schéma. Beaucoup des nouveaux producteurs cependant se positionnent avec la volonté de créer des “vins de garage” : des micros cuvées, haut de gamme, travaillées artisanalement, et qui entendent exprimer les qualités de leur terroir. Face aux vins du nouveau monde, qui inondent le marché international de certaines de leurs productions peu onéreuses, les vignerons libanais entendent jouer la carte d’une consommation qualitative, en phase avec les nouveaux modes de consommation au Liban comme dans le monde.
Consommation contrastée
Car les goûts, en matière de consommation, se modifient au Liban. La production reste certes à l’échelle du pays, de l’ordre de 52 500 hectolitres par an. On est bien loin des 53 millions annuels de la France (soit une consommation de six à huit bouteilles par habitant et par an) ou des 6,3 millions du Chili. Mais le Liban a une belle marge de manœuvre comme d’ailleurs des continents comme l’Asie ou l’Amérique. Car si la consommation mondiale est repartie à la hausse (aux alentours de 250 millions d’hectolitres) après quelques années de baisse, elle est avant tout tirée par les chiffres en provenance de continents comme l’Asie et l’Amérique, où le goût du vin est encore récent. En Europe, en revanche, la consommation par habitant a considérablement baissé durant les deux dernières décennies. En France, premier pays producteur de vins, cette chute a entraîné un excédent de production et la mise en place de “primes à l’arrachage” (33 000 hectares de vignes ont été supprimés en 2008).
Au Liban, comme le souligne Serge Hochar, président de l’Union vinicole du Liban, un syndicat réunissant les onze plus grands producteurs du pays, « ce sont surtout les jeunes générations qui se mettent au vin ». La consommation qui était surtout forte l’hiver commence à s’étendre sur l’ensemble de l’année. « C’est grâce au Sunset et au Myst, les rosés respectifs de Ksara et Kefraya, qui ont été calibrés pour la plage et qui ont bénéficié de grandes campagnes marketing », raconte un consultant-sommelier, qui souhaite conserver l’anonymat. La diversification de l’offre a fait le reste. Enfin, le léger recul de la consommation d’arak, entamé au début des années 2000, laisse une plus grande place au vin. Pour Charles Ghostine, administrateur délégué chez Ksara, ce déclin de la boisson nationale s’est accéléré avec la décision de Libnor, l’institut des normes libanais, d’autoriser la fabrication d’arak à partir d’alcool de mélasse (décret voté en 1999) et non plus exclusivement d’alcool de raisin.
Un marché en ébullition
Le marché local reste amplement dominé par les “deux grands” Ksara et Kefraya. À elles deux, ces caves produisent un peu plus de quatre millions de bouteilles. Dans le secteur off-trade, c’est-à-dire les supermarchés, caves et boutiques, Ksara et Kefraya représentaient à eux deux 78 % des ventes, en 2008, selon les chiffres fournis par Ksara. Si l’écart entre les deux reste, en fait, assez flou, la distance avec les autres est, elle, très claire. Selon les mêmes chiffres, Musar représenterait 6,3 % des ventes, Clos St.Thomas et Domaine Wardy seraient proche des 2 % chacun… En tout, les 11 membres de l’Union vinicole du Liban cumulent 80 % de la production.
Les vins importés représentent un peu moins de 20 % des ventes sur le marché local. En 2008, le Liban a importé 1,148 million de bouteilles principalement depuis la France, mais aussi depuis l’Espagne, l’Italie et la Bulgarie. Plus chers, ils sont essentiellement achetés dans les supermarchés ou les caves et consommés à la maison, pour éviter que ne se rajoute la marge des restaurants. Une donnée qui devrait changer avec la baisse des tarifs douaniers, intervenue cet été. Dans le cadre d’un accord avec l’Union européenne en effet, les taxes sont passées de 70 à 35 % sur les vins de qualité et de 70 à 56 % pour les vins « non qualitatifs ». Les vins originaires d’autres pays que ceux de l’UE restent taxés à 70 %. Pour les Libanais, très majoritairement consommateurs de Bordeaux quand ils boivent du vin étranger, cela signifie une baisse des prix. Mais pas de quoi affoler les producteurs locaux ! D’une part, parce que les prix de départ en Europe ont augmenté. D’autre part, car le Liban est un marché dollarisé et que l’euro reste très fort. De fait, la baisse de 12 points des taxes sur le vin non qualitatif est en partie annulée par la hausse de 10 % de l’euro. « Seules les bouteilles très chères à l’origine vont bénéficier de baisses conséquentes », résume Henri Debbané, d’Enoteca.
Le vrai bouleversement en termes de prix se fera en 2013 : plus aucune taxe douanière sur le vin ne sera appliquée, conformément aux accords du GATT signés par le Liban.
Un fort potentiel d’export
Parce que le marché local demeure restreint, tous les producteurs de vin libanais lorgnent vers l’export. Surtout les petites caves, qui parfois écoulent jusqu’à 80 % de leur production à l’étranger. En 2008, le Liban a exporté 2 426 000 bouteilles, dont 32 % vers le Royaume-Uni. Dans ce pays toutefois, la donne est légèrement faussée. Le Royaume-Uni servant de “plaque tournante” aux vins libanais pour ensuite être redistribués dans d’autres parties du monde. Des producteurs comme Musar, grand exportateur, en ont ainsi fait leur centre de distribution pour le monde entier. Suivent la France, destinataire de 16 % du vin libanais exporté, puis les Émirats arabes unis (8 %), la Syrie (7 %) et les États-Unis (6 %). L’export représente un chiffre d’affaires total de 13,129 millions de dollars, quand celui du vin importé est de 8,3 millions.
Sur ce terrain, tout le monde ne joue pas à jeu égal. Les plus gros ont la possibilité de s’appuyer sur des distributeurs, d’autres doivent se contenter de leurs contacts personnels et misent sur des rencontres lors des salons internationaux. Tous ne visent pas non plus le même public. La diaspora libanaise est, certes, la première cible. Mais les producteurs de vin sont de plus en plus nombreux à essayer d’élargir leur clientèle aux consommateurs nationaux. Pour cela, ils démarchent les connaisseurs, chroniqueurs et cavistes, afin de toucher les amateurs de vin. Beaucoup, comme Massaya et Karam par exemple, aimeraient que le vin du Liban fasse partie d’une troisième vague mondiale, pourquoi pas sous l’étiquette “Vins de l’Ancien Monde”, sur le modèle des “Vins du Nouveau Monde”, qui ont lancé les vins chiliens, argentins ou encore australiens. D’autres surfent sur la mode du bio et font certifier leurs vignobles “agriculture biologique”, comme Adyar ou le Domaine de Baal voire Musar, tous deux en cours de certification. Un positionnement d’autant plus efficace que le terroir libanais, qui se distingue par son ensoleillement, permet de limiter le recours aux pesticides et autres produits nocifs pour la santé des hommes.
Mais pour tous, il faudrait un meilleur encadrement de la production vitivinicole libanaise. D’une part pour une meilleure représentation à l’international, mais aussi pour que les efforts en termes de qualité soient reconnus, par exemple par une (ou des) Appellation d’origine contrôlée (AOC). Un label prévu par l’article 12 de la loi sur le secteur de 2000 peine à se mettre en place. Le décret d’application devrait être voté très prochainement. L’Institut national de la vigne et du vin (INVV), s’il est finalement créé, devrait aussi aider à ouvrir des portes au vin libanais.
L’Institut du vin et de la vigne attendu depuis 2000
Créé par l’article 18 de la loi de 2000 qui réglemente la production de vin au Liban, l’Institut national de la vigne et du vin n’a toujours pas vu le jour. L’objectif est d’organiser le secteur vinicole du pays à travers une institution de référence. Le décret a été signé, mais un problème persiste : le gouvernement a voulu éviter de participer aux frais de fonctionnement de l’INVV en effaçant simplement le paragraphe le mentionnant parmi les pourvoyeurs de fonds. Mais, ce faisant, l’État s’est privé de la possibilité de nommer le directeur et les membres de l’organisme, car cette faculté est tributaire d’une contribution budgétaire. Le temps pour les professionnels du secteur d’alerter les cinq ministres concernés par le dossier (Finances, Économie, Industrie, Agriculture et Affaires sociales) et les élections ont eu lieu. Les négociations devraient reprendre dès que possible, selon un membre de l’Union vinicole du Liban.
La mission de l’INVV est de gérer tout ce qui a trait à la viticulture et à la viniculture au Liban, que ce soit sous les aspects légaux ou commerciaux. Il sera aussi chargé du contrôle qualité des vins, avec un laboratoire capable d’établir la traçabilité des raisins, de leur provenance aux cépages utilisés. La loi prévoit également qu’il puisse « créer un système similaire au système français » et donc notamment mettre en place des Appellations d’origine contrôlée (AOC) fonction des différentes régions de production du pays.
Enfin, l’Institut doit faire le lien entre les producteurs et l’Organisation internationale du vin, à laquelle le Liban a adhéré en 1995, « afin de mettre en application ce qui est possible », dixit la loi, c’est-à-dire de transcrire au Liban les décisions prises par l’OIV. Tous les producteurs de vin, et notamment les membres du syndicat de l’Union vinicole du Liban, appellent de leurs vœux la création d’une telle structure tant pour mieux définir la production de vin de qualité qu’afin de pouvoir le promouvoir localement et à l’étranger. Selon eux, cet Institut pourrait leur ouvrir de nouveaux marchés, notamment en assurant et garantissant la qualité du vin et des vignes, qu’il surveillerait.
Alfred Asseily a investi 500 000 dollars dans la cave de son restaurant
Trois questions au propriétaire de La Table d’Alfred d’Achrafié
La Table d’Alfred a investi dans une véritable cave pour conserver le vin dans les meilleures conditions ? Pourquoi un tel pari ?
Dès l’ouverture de La Table d’Alfred en 1997, nous avons proposé un choix de bouteilles important et diversifié. La cave nous a coûté 35 000 dollars. Elle est accessible directement depuis nos salles et nous incitons nos clients à s’y rendre et choisir par eux-mêmes, avec l’aide éventuelle de notre sommelier. À cet investissement initial, il faut ajouter le stock de bouteilles achetées. En 1997, nous avions une centaine de références. Aujourd’hui, notre stock représente un investissement d’un demi-million de dollars avec quelque 500 cols. Le vin représente 80 % de nos ventes de boissons. D’où, pour nous, l’importance d’une carte très ambitieuse et variée.
Comment votre carte des vins se distingue-t-elle des offres des cavistes ou des autres restaurants ?
Comme restaurateur, nous avons un rôle à tenir dans “l’éducation gustative” de nos clients, en leur proposant des “vins découvertes” ou des associations mets et vins harmonieuses. Chaque six mois, la carte des vins est entièrement revisitée. Bien sûr, nous proposons des valeurs sûres comme l’appellation Margaux, très demandée. Mais nous faisons notre possible pour faire connaître à nos clients des vins plus originaux.
Depuis peu, par exemple, nous disposons d’un système sous azote, qui permet de proposer des vins au verre. Il faut savoir que, sans conservation, une bouteille ouverte n’est plus consommable le lendemain. Avec ce système, nous pouvons “tirer” le vin de la bouteille, même de grand millésime, et le conserver presque un mois avec toutes ses qualités gustatives.
Le vin libanais est-il très demandé à La Table d’Alfred ?
Les vins libanais représentent 10 % environ de notre carte. Soit une soixantaine d’étiquettes. Pour nous distinguer des cavistes, nous parions sur des millésimes quasi impossibles à trouver ailleurs. C’est le cas, par exemple, pour des domaines comme Kefraya (96, 97, 99) ou Musar (67, 70, 72). Mais nos ventes restent cependant très orientées vers les vins étrangers, français en priorité.
Glossaire
Assemblage : mélange de plusieurs cépages dans un même vin.
Barrique : récipient en bois de chêne utilisé pour la conservation des vins de garde.
Vin de garde : un vin qui demande à vieillir plusieurs années en cave pour se bonifier.
Vin de garage : un vin produit en toute petite quantité sur de petites surfaces, souvent avec des moyens marketing et commerciaux limités, mais (souvent) des vins de grandes qualités.
Bouche : terme désignant l'ensemble des caractères perçus dans la bouche au moment de la dégustation d’un vin.
Caudalie : unité de mesure de la durée de persistance en bouche des arômes du vin.
Cave : lieu où est entreposé le matériel destiné à la vinification et où celle-ci est effectuée. Par extension, ce terme désigne un producteur de vin et sa marque.
Cépage : variété de plants de vigne. Il existe des cépages classiques, pour le raisin de table, et des cépages de cuve, destinés au vin.
Chai : entrepôt où les fûts sont stockés.
Col : synonyme de bouteille.
Conduite en gobelet : c’est une forme de “conduite” de la vigne utilisée dans le bassin méditerranéen. Par une taille basse, dont la forme peut s’apparenter à une griffe, elle permet à la vigne de s’endurcir de gagner une meilleure résistance au vent et à la sécheresse et une moindre sensibilité aux maladies du bois. La vigne n’est pas palissée.
Cuve : récipient en béton, bois ou inox dans lequel on place le jus de raisin et les peaux durant la fermentation. Les matières solides restent en contact avec le jus en fermentation dans la cuve, ce qui permet notamment de donner au vin sa couleur.
Élevage : ensemble des opérations destinées à préparer les vins du vieillissement jusqu'à la mise en bouteilles.
Fermentation : processus de transformation du jus de raisin en vin. Elle comprend deux phases, la fermentation alcoolique qui transforme le sucre en alcool grâce à l’action de levures et la fermentation malolactique, qui transforme l'acide malique en acide lactique et gaz carbonique, ce qui rend le vin moins acide.
Levures : champignons unicellulaires microscopiques provoquant la fermentation alcoolique. Il existe des levures indigènes (naturelles) et d’autres chimiques.
Monocépage : vin constitué du jus fermenté d’un seul cépage de raisin. S’oppose à assemblage.
Œnologie : science du vin.
Palissage : action qui consiste à étendre les branches d’un arbre (ou les rameaux d’une vigne) contre un mur ou contre un étendoir (fil acier ou enrobé de plastique) afin de permettre aux fruits de profiter d’une exposition optimale au soleil. L’une des règles de la culture de la vigne veut en effet que les rameaux ne touchent pas le sol, car ils prendraient racine.
Robe : terme employé pour désigner la couleur d'un vin et son aspect extérieur.
Tanins : substances d'origine organique que l'on trouve dans beaucoup de végétaux et qui sont très présents dans les pépins de raisins. Ils font partie des déterminants du goût d’un vin.
Vinicole : qui a trait à la production de vin
Viticole : qui a trait à la culture du raisin de table ou de cuve. Combien coûte une cave ?
Trois question à… Diana Salamé, œnologue indépendante, conseillère du Château Belle-Vue et d’Atibaia
Quel matériel faut-il pour vinifier le raisin ?
Il faut prévoir l’achat de plusieurs machines comme un égrappoir, qui sépare les grumes (les baies) de la rafle (la partie végétale), ainsi qu’une pompe. Ensuite, il faut se procurer des cuves, dans lesquelles les baies et leur jus sont entreposées le temps de la fermentation, c’est-à-dire le temps que le sucre se transforme en alcool. Puis, on presse le vin à l’aide d’un pressoir. Pour les vins rouges, on peut l’élever en barriques. L’achat de ce matériel ne dépend pas de la taille du domaine. Ils sont inhérents à la production viticole. La majorité de ces machines est importée d’entreprises européennes, françaises, italiennes ou espagnoles. Ce qui induit un coût supplémentaire lié au cours haussier de l’euro.
Quel est le coût d’une telle installation ?
Dans le cas d’une production “amateur” – soit environ 2 à 3 000 bouteilles par an –, on peut considérer que, outre le matériel de base (égrappoir, pressoir, pompe), deux cuves en inox et deux barriques seront suffisantes. Il faudra aussi une boucheuse, pour la mise en bouteilles. Cela représente en tout un investissement d’environ 10 000 dollars. La plupart des vignerons “amateurs” utilisent ensuite un bâtiment – leur garage, une cave – qu’ils possèdent déjà et où ils entreposent leur production.
Et lorsqu’on est le propriétaire d’un véritable domaine viticole ?
Dans le cas d’une cave de taille moyenne, qui produit 10 à 50 000 bouteilles par an, l’échelle est tout autre : de 100 à 250 000 dollars sont nécessaires. Il est cependant difficile d’avancer un ordre d’idées. Car toute dépend des ambitions du propriétaire et, en particulier, du niveau de sophistication de l’équipement recherché. Le prix d’une cuve peut varier du simple au sextuple. Sans compter que, dans ce cas, le “garage” ne peut suffire au respect des normes internationales et qu’il faut construire soit une cave indépendante, soit un hangar séparé. Les coûts peuvent rapidement grimper jusqu’à un million de dollars.
Déjà abonné ? Identifiez-vous
Les articles de notre site ne sont pas disponibles en navigation privée.
Pour lire cet article, veuillez ouvrir une fenêtre de navigation standard ou abonnez-vous à partir de 1 $.
Pour lire cet article, veuillez ouvrir une fenêtre de navigation standard ou abonnez-vous à partir de 1 $.